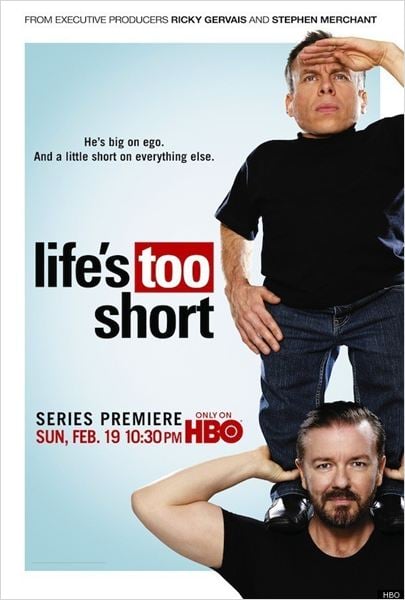Le coup de la panne
Le Pitch: Le monde bascule dans une ère sombre lorsque l'électricité cesse soudainement de fonctionner. Sans technologie moderne, les hôpitaux, les transports et les moyens de communication ne sont plus opérationnels. La population doit réapprendre à vivre... 15 ans plus tard, la vie a repris son cours. Lentement. Sereinement ? Pas vraiment. Aux abords des communautés agricoles qui se sont constituées, le danger rôde. Et la vie d'une jeune femme est bouleversée lorsque la milice locale débarque et tue son père, qui semble être mystérieusement lié au blackout. Ces révélations l'amènent à se mettre en quête de réponses sur le passé, dans l'espoir d'un futur meilleur.
Mon avis: Après dix épisodes et avant la reprise prévue dans deux mois, j’ai envie de faire un point sur la nouvelle série « de » J.J. Abrams, Revolution. Je mets des guillemets parce qu’on a tendance à la définir ainsi alors que le véritable showrunner est Eric Kripke, modeste créateur de Supernatural. Ce raccourci, souhaité sans doute par la production, nourrit la paresse médiatique, et celle du spectateur, en proie parfois à certains doutes quant au « qui fait quoi » dans les séries américaines. Une ambiguïté sur le modus operandi créatif qui met à mal notre chère Politique des Auteurs mais je m’étendrai sur ce sujet une autre fois.
Peu importe ce que l’on pense de Lost (les ennuyeux épisodes flashback des premières saisons, les incohérences scénaristiques, le salmigondis crypto-religieux, la fin décevante…), le fait est que depuis sa disparition, aucune série ne l’a remplacée dans le cœur du grand public, au sens large, de l’amateur de séries occasionnel au geek ultime capable d’organiser des réunions secrètes dans sa cave avec ses amis imaginaires pour réviser furieusement, à défaut de se pendre avec, la théorie des cordes. Pourquoi diable Revolution réussirait là où d’autres séries fantastiques à gros budget, comme Flashforward et The Event, se sont lamentablement plantées ?
Premier élément de réponse : c’est une série qui est taillée pour durer. A partir d’une idée on ne peut plus simple, à savoir la disparition de l’électricité, Kripke a ouvert un champ des possibles hallucinant, une boîte de Pandore scénaristique au potentiel inépuisable. Non pas en s’acharnant à dépeindre les nouveaux modes de vie d’une civilisation privée de courant mais plutôt en réactivant le modèle des séries « itinérantes » dans lesquelles les protagonistes sont toujours en mouvement, que ce soit à pied, à cheval, en voiture ou en vaisseau spatial, avec un objectif plus ou moins précis en tête. La particularité de ces séries est que chaque épisode offre aux personnages une digression picaresque leur permettant de renverser un ordre établi tout en les rapprochant quand même de leur objectif initial. Pour simplifier, c’est une grande aventure parsemée de petites. D’où, a priori, des situations nouvelles à chaque épisode et donc un réservoir à histoires pouvant entretenir l’intérêt du téléspectateur pendant un certain temps. Comme dans Star Trek, Kung Fu, Stargate, voire même Sliders et K2000 ! Tiens, tiens…Star Trek… on devine l’empreinte d’Abrams. Qui plus est, privés d’énergie, les héros de Revolution ne sont pas mieux lotis que les îlotiers de Lost. Sauf que potentiellement, niveau surface à arpenter, y a pas photo.
C’est d’ailleurs le deuxième point important : l’aspect ludique de l’entreprise, terriblement excitant. Les personnages, et donc les téléspectateurs, ont tout un monde, voire plusieurs, à (re)découvrir tandis qu’ils se découvrent eux-mêmes. Ce reboot géant, véritable fantasme anarchiste, dessine de nouveaux terrains de jeu, change les règles de ce jeu et inverse les rôles dominants/dominés. La globalisation est morte et enterrée, le monde n’est plus un village mais en revanche chaque village est un monde à part entière ce qui, encore une fois, sied parfaitement au morcèlement épisodique. A chacun de pouvoir se situer sur ce nouvel échiquier, sous peine de disparaître.
Ce qui nous amène à l’idée directrice, à mon sens, de cette série, en tous cas de cette première partie de saison. La régression matérielle et technologique n’entraîne pas forcément la régression morale et humaine, sauf chez ceux qui veulent à tout prix « retrouver la lumière ». Paradoxe intéressant : rétablir l’électricité serait synonyme de régression puisque cela ne servirait qu’à réactiver les machines de guerre et prendre le contrôle de la planète. Les vilains méchants de la République Monroe ne sont que des hommes des cavernes modernes à la recherche du feu pour attaquer le voisin. Monroe, soit dit en passant, est à mon avis une référence au Président James Monroe (1758-1831) et à sa doctrine ambigüe qui posa les bases de l’isolationnisme américain, soit un repli sur soi autant qu’un désir de conquête du reste du continent, ce qui colle bien au personnage de Bass. En revanche, les autres protagonistes, qu’ils soient dans le Résistance ou non, semblent s’être adaptés tant bien que mal et ne courent pas après le courant. C’est là où le titre prend son sens, il s’agit bien d’une « re-évolution » et pas d’une régression. L’écran-titre lapidaire le montre bien en faisant apparaître d’abord le mot « evolution » avant de faire clignoter et d’ajouter la lettre « r » devant. Le retour en arrière est donc une forme d’évolution qui met notamment en valeur les capacités d’adaptation des hommes telles que l’habileté, la ruse, le système D et, pour la Résistance, le courage, le panache et l’héroïsme.
Voilà pourquoi Revolution a tout du divertissement haut de gamme, en attendant la suite. On prend plaisir à suivre cet « eastern » par opposition au western puisque les personnages vont d’ouest en est, de Chicago à Philadelphie pour être précis (il y en a même un qui veut retourner sur le Vieux Continent !). Plaisir accentué par les divers clins d’œil et références que l’on peut, pour le coup, attribuer à J.J. Abrams. Par exemple, le nom de famille des héros est Matheson (vous reprendrez bien un peu d’onomastique ?). C’est évidemment un hommage à l’auteur de science-fiction Richard Matheson, qui non seulement a écrit des ouvrages sur des mondes post-apocalyptiques comme le fameux Je suis une légende, mais a en plus rédigé des scénarii pour des épisodes de La quatrième dimension et…Star Trek. Si l’évidence de l’hommage ne vous a pas saisi, j’ajoute alors qu’il est l’auteur du scénario, adapté d’une de ses nouvelles, de Duel, le premier film de l’idole absolue d’Abrams, Steven Spielberg… Mais notre ami J.J. est également féru de Star Wars, à tel point qu’il réalisera prochainement l'épisode VII de la saga.
Ainsi, Revolution est saturée de références à l’univers de George Lucas, à tel point qu’on pourrait la rebaptiser Light Wars. Quelques exemples pêle-mêle : l’effrayant Giancarlo Esposito (Captain Neville) est un bras droit digne de Dark Vador (d’autant que c’était un gentil devenu méchant à cause du pouvoir); le badass cynique Miles Matheson se la joue Han Solo en protégeant un jeune frère et sa sœur (les Skywalker); leur gros pote barbu est un parfait Chewbacca; ils aident une ribambelle d’orphelins qui se battent comme des Ewoks; ajoutez des lasers aux sabres et vous obtenez fort logiquement des combats aux sabres laser; l’usine de Philadelphie fait une parfaite Etoile Noire; lors du duel final du 10ème épisode, « L’Empereur » Monroe propose à Matheson de le rejoindre de son côté qui, même s’il veut la lumière, n’en reste pas moins très obscur...
La victoire relative de la Résistance en cette fin de première partie de saison laisse augurer une réplique violente. Nous attendons désormais avec impatience que la République, à défaut d’Empire, contre-attaque.
/http%3A%2F%2Fblog.slate.fr%2Ftetes-de-series%2Ffiles%2F2013%2F04%2FSeries-Mania-saison-4_programme.jpg)



/http%3A%2F%2Fwww.lemouv.fr%2Fsites%2Fall%2Fthemes%2Fmouv%2Fimages%2FOJD.gif)



/http%3A%2F%2Fprofile.ak.fbcdn.net%2Fhprofile-ak-snc6%2F592213_249799381726318_2062199316_q.jpg)