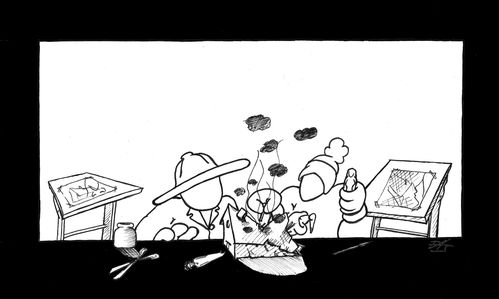Ryan erre
L’irrésistible George Clooney dans une comédie mi-figue mi-raisin. Reitman est doué mais son cynisme bien-pensant a du mal à nous convaincre.
Le pitch: L’odyssée de Ryan Bingham, un spécialiste du licenciement à qui les entreprises font appel pour ne pas avoir à se salir les mains. Dans sa vie privée, celui-ci fuit tout engagement (mariage, propriété, famille) jusqu’à ce que sa rencontre avec deux femmes ne le ramène sur terre. Ryan Bingham est un collectionneur compulsif de miles aériens cumulés lors de ses incessants voyages d’affaire. Misanthrope, il adore cette vie faite d’aéroports, de chambres d’hôtel et de voitures de location. Lui dont les besoins tiennent à l’intérieur d’une seule valise est même à deux doigts d’atteindre un des objectifs de sa vie : les 10 millions de miles. Alors qu’il tombe amoureux d’une femme rencontrée lors d’un de ses nombreux voyages, il apprend par la voix de son patron que ses méthodes de travail vont devoir évoluer. Inspiré par une nouvelle jeune collaboratrice très ambitieuse, celui-ci décide que les licenciements vont pouvoir se faire de manière encore plus rentable, via... vidéo conférence. Ce qui risque évidemment de limiter ces voyages que Bingham affectionne tant...
Mon avis: Après Thank you for smoking et Juno, voici donc la troisième réalisation du désormais très estimé Jason Reitman et, comme les précédentes, elle repose avant tout sur son personnage principal. Le réalisateur excelle à mettre en place et présenter son « héros », d’où ces vingt premières minutes savoureuses durant lesquelles on suit et on découvre toutes les facettes de la vie de Ryan Bingham auquel George Clooney prête ses traits narquois. Une vie littéralement suspendue, dépourvue d’attaches et de passé, uniquement vouée à cet objectif totalement dérisoire : atteindre les 10 millions de miles de vol. La musique et le montage épousent de manière inventive, et avec un certain brio, les contours bien définis de cet homme allégé, sorte de figure ultime de l’individualisme moderne dont l’égoïsme froid est en réalité nourri par une peur viscérale de la mort. Bien sûr, nous sommes dans une comédie romantique et une femme va venir semer le trouble chez cet homme-tortue dont la maison ne tient que dans un sac. Mais le cynisme qu’il dégage est aussi attirant que repoussant, en plus d’être hautement comique, ce qui fait de lui un personnage à l’ambiguïté finalement assez rare au cinéma.
Malheureusement ce cynisme se pare d’un humanisme fort malvenu. La faute à cette fâcheuse tendance, typiquement américaine, qui consiste à systématiquement dégager le côté positif d’une situation
avec un aplomb terrifiant. Il y a une scène détestable qui illustre cela. Celle où Bingham tente de réconforter un employé licencié désespéré en lui expliquant qu’il doit se tourner vers sa
famille et tenter une carrière de cuistot parce qu’il avait pris l’option cuisine à l’école ! Là nous ne sommes plus dans le second degré corrosif mais dans le foutage de gueule complet.
C’est d’autant plus choquant que les entretiens de licenciement sont filmés comme un documentaire et sont inspirés de témoignages réels, le tout pour coller bien sûr avec la crise qui a secoué le
monde pendant le tournage. C’est profondément irrespectueux et malsain.
Au final, nous sommes tiraillés entre les réelles qualités de ce long métrage (acteur, humour, montage, musique) et ses défauts insupportables. L’emballage de ce produit est certes séduisant mais
le kit de pensée préfabriquée fourni avec est en trop. A vous de voir.





 A cela s’ajoute
paradoxalement une dimension comique indéniable. Réapprendre à aimer et gérer les aléas de l’adultère en sont les deux principaux ressorts. Les rendez-vous manqués, les chambres d’hôtel (de luxe)
réservées, les plans délirants sur la comète ( « Viens, allons vivre à Barcelone, si on part maintenant, on peut y être dans 4 heures ! »), autant de situations cocasses qui
rendent ce couple irrésistible. En redécouvrant la séduction, ils retombent ensemble dans une adolescence gauche, touchante et intemporelle. Des jeux d’enfants toutefois menacés par
l’omniprésence de l’alliance de Mathieu, minuscule objet qui envahit pourtant l’écran lorsque sa main caresse fiévreusement le corps de Maya.
A cela s’ajoute
paradoxalement une dimension comique indéniable. Réapprendre à aimer et gérer les aléas de l’adultère en sont les deux principaux ressorts. Les rendez-vous manqués, les chambres d’hôtel (de luxe)
réservées, les plans délirants sur la comète ( « Viens, allons vivre à Barcelone, si on part maintenant, on peut y être dans 4 heures ! »), autant de situations cocasses qui
rendent ce couple irrésistible. En redécouvrant la séduction, ils retombent ensemble dans une adolescence gauche, touchante et intemporelle. Des jeux d’enfants toutefois menacés par
l’omniprésence de l’alliance de Mathieu, minuscule objet qui envahit pourtant l’écran lorsque sa main caresse fiévreusement le corps de Maya.