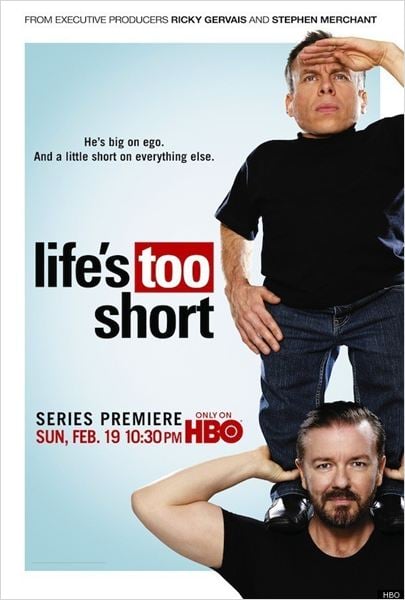The never ending series
Combien de saisons une série doit-elle durer ? A quel moment commence-t-elle à tourner en rond ? Faut-il abandonner une série qui a déjà tout dit et rester sur un goût d’inachevé ou bien se faire violence pour connaître la fin à tout prix ? Autant de questions existentielles et de drames cornéliens pour nous autres, pauvres hères, qui subissons quotidiennement la loi des séries.
Vous aussi, vous avez sans doute dans votre ordi des séries qui pourrissent, qui se languissent d’être visionnées. Vous aussi, lorsque vous devez décider du programme de la soirée, vous faites semblant de réfléchir, et pour faire plaisir à ces œuvres autrefois tant aimées, vous passez lentement la souris sur leurs titres avant de vous jeter inexorablement sur « Vikings » et « Revolution », qui devraient arrêter de faire les malignes car le purgatoire n’est jamais bien loin.
Hormis les comédies et sitcoms, et selon la Sainte Trinité de mes séries préférées (Six Feet Under, The Wire et Breaking Bad), la bonne durée de vie d’une série est de cinq saisons. Malheureusement, succès oblige, certaines ne respectent pas cet état de fait et n’en finissent plus de finir. En voici quelques unes, anciennes ou récentes.

-X-Files : Trop de mystère tue le mystère. Chris Carter l’avait pourtant juré dans de nombreuses interviews que nous, les boutonneux des années 90, épluchions avec ferveur : « Je sais où je vais, rassurez-vous, vous saurez tout en temps voulu de la conspiration entre le gouvernement américain et les aliens » (in Télé Poche du 1er mars 1996). Malheureusement, à part découvrir avec stupéfaction que l’Homme à la Cigarette était directement responsable des assassinats de JFK et MLK(???!!!), on n’a pas vu grand-chose venir. On a surtout vu Mulder partir, un épisode sur deux, remplacé par le T-1000. J’ai laissé tomber à ce moment-là mais j’ai vu plus tard un extrait du tout dernier épisode, dans lequel l’Homme à la Clopinette (encore lui) semble vivre reclus comme un chaman dans une grotte qu’un vaisseau extra-terrestre vient exploser sans vergogne. Puis on voit Mulder et Scully dans une chambre, exactement comme dans une des premières scènes du pilote de la série où il lui disait croire aux petits hommes verts, sauf qu’il lui annonce cette fois qu’il ferait peut-être mieux de croire en Dieu comme elle. Bref du grand n’importe quoi.

-Urgences : Se faire faire NFS, Chimi, Iono, les gaz du sang et 2cc de O2 pendant 15 ans, ce n’est plus de l’addiction mais du masochisme. Enorme succès à rallonge, Urgences a logiquement vu ses scénaristes finir aux soins palliatifs, reliés à l’encéphalogramme plat du soap-opera. Pour moi, le point de non-retour fut atteint avec la mort du Dr Green. Simplement parce que l’acteur Anthony Edwards a lâché la série pour se lancer au cinéma (une réussite d’ailleurs, hé hé hé), on se venge en lui filant une tumeur au cerveau, au lieu d’une paisible retraite au bord d’un lac comme son ancien pote le Dr Ross et sa « good wife ». C’est mesquin. Je n’ai jamais regretté de ne pas avoir suivi les dernières saisons, surtout quand j’ai appris l’arrivée de John Stamos de La Fête à la Maison. Avec Stamos dans l’équipe, c’est un coup à voir débarquer au bloc oncle Joey imitant un castor lors d’une opération à cœur ouvert…
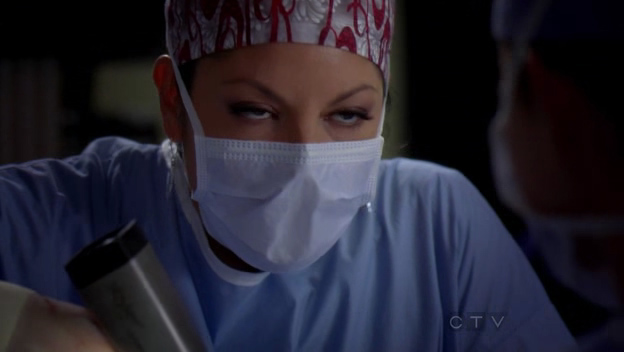
-Grey’s Anatomy : Dans la lignée de la chute d’Urgences. Vous me direz, c’était déjà un soap à la base. Oui mais un soap plutôt malin, drôle, sexy et enlevé. Puis Grey’s a sombré dans les travers de la série de Michael Crichton : tumeur au cerveau, fusillades à gogo, accidents malheureux et la mort de George carrément pompée sur celle du binôme du Dr Carter. Quant à l’horripilant personnage fantôme Denny Duquette, c’est l’un des pires jamais écrit dans une série.

-Prison Break : Contrairement aux séries précédentes, il n’a pas fallu beaucoup de saisons à Prison Break pour être interminable. Seulement deux. Un vrai tour de force. Un succès planétaire brisé en un rien de temps pour une raison assez facile à comprendre finalement : ils n’auraient pas dû s’évader dès la fin de la première saison. Certes la cavale aurait pu être intéressante. Après tout, les personnages restent prisonniers non plus d’une institution pénitentiaire mais du territoire américain. Sauf que toute la tension, brillamment accumulée au cours du premier acte, s’est faite la malle en même temps que les protagonistes. Quand les scénaristes décident d’enfermer à nouveau tout ce petit monde pour la saison 3, il est déjà trop tard. Le reste n’est qu’idioties et…tumeur au cerveau bien sûr.

-Dexter : Oui je sais, on l’aime bien Dexter. Sauf qu’il commence sérieusement à radoter. Tout ce qui était fascinant chez ce personnage, son cheminement intérieur, son incompréhension des sentiments, ses accès de violence compulsive, tout cela s’est dilué au fur et à mesure dans un honnête polar, pour peu que le méchant saisonnier soit réussi. Le plus regrettable, c’est que toutes les facettes de l’histoire sont là pour faire évoluer notre gentil serial killer, pour qu’il se questionne sur sa nature humaine mais il ne le fait jamais tout à fait et finit par se reposer les mêmes questions la saison suivante. Après la mort de Rita, Dexter a sans doute manqué son renouvellement. On aurait aimé qu’il taille la route, comme c’était son intention initiale, au lieu de retourner à son train-train quotidien. Bref, heureusement qu’il y a Debra et surtout heureusement que la prochaine saison sera la dernière !

-Californication : Duchovny, deuxième ! Là encore, les qualités indéniables de cette série se sont émoussées au fil du temps. La provoc’ sexe, drogue et rock ‘n’ roll s’est banalisée, la relation contrariée entre Karen et Hank nous indiffère désormais et le schéma reste invariablement le même : chaque saison, Hank doit se relancer en pondant un truc pour une légende du rock (ou, attention variante, du rap), chaque saison il s’engueule avec son ex et sa fille, chaque saison il a l’occasion de changer de vie et chaque saison il replonge. Comme pour Dexter, un tournant a été manqué, après le procès de Hank, lorsque trois ans s’écoulent entre deux saisons. Las, cette ellipse n’a apporté aucun changement chez le personnage qui se traîne douloureusement vers un ultime acte que l’on appelle de tous nos vœux.

-Weeds : Pour tout vous dire, c’est Weeds qui est à l’origine de ce petit billet. Impossible de terminer la dernière saison. C’est une véritable torture de lancer un épisode, alors qu’il ne m’en reste que six à regarder. Je ne peux pas non plus compter sur l’appui de ma femme puisqu’elle ressent la même chose que moi. Le plus dingue, c’est que Weeds est sans doute la meilleure série de cette sélection, et si on m’avait dit lors des premières saisons que j’aurais autant de mal à voir la fin, je n’y aurais pas cru. Comment une série qui faisait preuve d’autant de finesse, d’humour, d’intelligence et de liberté de ton à ses débuts, peut-elle susciter autant d’indifférence à l’heure de sa conclusion ? Le début de la fin a sans doute été le départ d’Agrestic. Si les deux saisons suivantes ont été encore à la hauteur, la fuite en avant perpétuelle des personnages a entraîné leur perte, au sens où ils ont perdu leur vitalité fictionnelle, se sont vidés de leur substance, ont abandonné leurs caractères profonds pour ne garder que des caractéristiques superficielles. En fait, ils sont devenus les caricatures des merveilleux personnages qu’ils incarnaient, en grande partie à cause du bégaiement des intrigues qui progressent en pilotage automatique. Nancy est insupportable, Andy souffre du « syndrome Chandler » (il est l’ombre de lui-même depuis qu’il est en couple), Doug ne sert plus à rien, l’acteur qui joue Silas a grandi et, ô surprise, n’est en fait pas un acteur, etc. Bref, alors qu’on aurait dû avoir la gorge qui pique et les yeux rouges (normal pour la fin d’un joint) à l’idée de quitter cette petite troupe, on s’en est allé avant la fin, histoire de voir si l’herbe n’était finalement pas plus verte ailleurs…